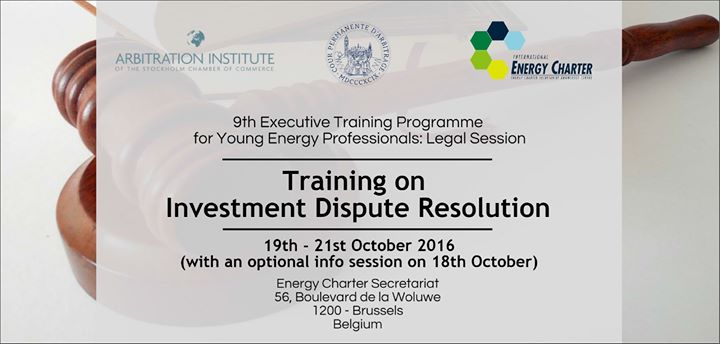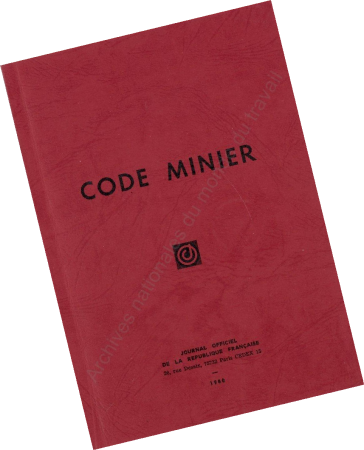Voulue dès 1990, signée en 1994 (après la version « Europe » en 1991), renforcée en 1998, la Charte internationale de l’énergie de 2015 est l’exemple d’une bonne idée initiale pour les Nations qui finit en outil aux mains du privé. Comme l’Italie qui en est sortie il y a un peu plus de dix-huit mois, il nous semble urgent que la France fasse de même sans délai. Par la même occasion l’exécutif serait bien avisé de tenir l’annonce du quinquennat précédent incarnée par l’actuel Président d’adhérer à l’Initiative pour la transparence des industries extractives. Tiens cela pourrait aller avec le réexamen du projet Montagne d’Or évoqué par notre nouveau ministre !
Née en juin 1990 en pleine transformation de l’Union soviétique, l’idée d’une Charte européenne de l’énergie permettant aux nations européennes de s’affranchir quelque peu de l’Opep à l’origine des « chocs » pétroliers de 73’ et 79’, en accédant -sous conditions- aux réserves hydrocarbonées de l’ex-URSS, a été formalisée par la Commission européenne vers un premier accord en 1991. La contrainte juridique de cet accord naîtra fin 1994 avec le Traité sur la Charte de l’énergie. Lequel traité entrera en vigueur en 1998 par ratification d’un nombre suffisant de signataires. Enfin, la version actuelle sera validée en 2015 à partir d’un document de travail.
Les principales dispositions de la Charte concernent la protection des investissements, l’application des règles de l’OMC pour le commerce des matières et produits énergétiques, en d’autres termes la libéralisation des prix, l’interdiction d’interrompre ou d’interdire le flux de matières premières ou de transit en cas de litige, ainsi que des procédures très rigoureuses de règlement de conflits entre États membres.
Les personnels de la Charte, avec des spécialistes, organisent des formations à l’arbitrage et d’autres réjouissances.
Bien qu’elle ait signé le Traité de la Charte dès 1994, la Russie n’a jamais voulu ratifier l’accord, ce qui a empêché la réalisation de l’objectif initial de celui-ci, à savoir réguler la commercialisation des énergies entre les pays européens et l’ex-URSS. En effet, Moscou (Gazprom !) veut conserver la maîtrise des prix de ses produits pour l’instant en grande partie extraits de gisements de « républiques » de l’ex-URSS et distribués via des infrastructures transfrontalières. Ainsi des conflits récurrents entre la Russie et ses satellites historiques éclatent régulièrement, mais sont toujours résolus à l’avantage de Gazprom, qui maintien ainsi des prix aux nations européennes inférieurs de ceux du marché international, moyennant des arrangements, parfois tendus, avec les pays accueillant les infrastructures de transit. Cet outil de dépendance économico-énergétique est vital dans la géostratégie du Kremlin. Cet aspect Europe-Russie est traité depuis 2000 par un « dialogue énergétique » bilatéral qui échappe aux Parlements nationaux. Voir le point de situation de la Documentation française de 2008, aussi L’énergie dans les relations Europe-Russie, moteur de coopération ou arme de guerre – Claude Nigoul, 2014.
Par ailleurs la Charte, initialement européenne, s’étend régulièrement à d’autres États permettant à des entreprises de toutes tailles de s’imposer sur les différents segments commerciaux de l’énergie ; prospection de ressources, exploitation et distribution de celles-ci, gestion d’infrastructures, et même régulation de marchés.
La dimension de contrainte juridique permet à travers des mécanismes d’arbitrage régis par le Centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements qui dépend du Groupe de la Banque mondiale -écartant ainsi les juridictions nationales- d’obtenir des compensations, dédommagements et autres… très substantiels à ce niveau.
Cette extension est suivie notamment par le Transnational Institute (TNI) qui conjointement avec le Corporate Europe Observatory (CEO) a publié en juin dernier le rapport One treaty to rule them all. Voir la présentation en français.
Un exemple géographiquement proche et récent est le litige qui oppose la compagnie britannique Rockhopper et l’Italie* suite à la décision de Rome d’interdire les recherches offshore dans le plateau continental, résultat des mobilisations citoyennes de 2016. L’arbitrage se poursuit et « les » Rockhopper demanderaient à ce jour 350 m d’€ de manque à gagner… Dès 2015 l’Italie a engagé le processus de sortie de la Charte, finalisé début 2016 et cela ne semble pas impacter son approvisionnement énergétique. Faisons confiance aux hauts fonctionnaires italiens pour négocier des accords bilatéraux sans aller s’enferrer plus avant dans ces mécanismes mettant les démocraties encore plus à la merci des intérêts privés.
En 2011 Schuepbach a fait le mauvais choix, heureusement pour nous !
Car en déclarant très explicitement vouloir employer la FHC sur les permis de Nant et VdB il s’est mis en position de faiblesse, projetant ainsi d’enfreindre la loi « Jacob » , il a donc subi l’abrogation imparable de ses deux permis ! Ses recours sont donc tombés sous le coup de la juridiction administrative nationale excluant de fait tout accès à un arbitrage via le dispositif de la Charte ! Mais Martin… a certainement été mal conseillé… déjà que selon nos sources il avait une haute opinion de lui-même et des certitudes quasi trumpiennes qu’il assénait régulièrement à ses interlocuteurs.
Le Conseil d’État a nommé fin 2017 un expert qui devraient rendre bientôt si ce n’est déjà fait, un rapport sur les dédommagements pour études d’amonts et frais de dossiers du suisso-texan. Qu’en pense son conseil ainsi que le Président du CHNC qui avait alors joué le rôle de lobbyiste en chef ?
Sur les supposées ressources d’hydrocarbures indigènes, comme l’indique le rapport « Délais d’instruction des demandes… » de 2015, limiter les effets de la Charte est possible. C’est ce que font les britanniques avec leur système d’appel à projets annuels sur des blocks définis et le principe du Drill or Drop. En France le code minier n’a jamais été actualisé vers une doctrine assumant clairement le volontarisme de l’État. En effet mieux vaut, à l’évidence, un système où le donneur d’ordre est en position de force que l’actuel mécanisme d’open bar. Lequel autorise l’afflux en continu sur toute partie du territoire libre de droits de demandes d’octroi démultiplié par l’obligation de mise en concurrence !
Mais notre nouveau ministre ainsi que son collègue de Bercy ont-ils vraiment dans leurs feuille de route fixée depuis le Château la refonte de ce code ? Comment ? Par Ordonnance… À partir de quel projet ? De la proposition Tuot fin 2013 dont toute mention vient d’être retirée de minéralinfo ? De la PDL « Le Roux » qui… s’empoussière au Sénat sous la forme de la petite loi n°890 ?
Cet aspect n’a pas été modifié par la loi « Hulot » qui a juste introduit l’article L111-9 du code minier disposant que plus aucun permis ne serait délivré (sauf décision de « force de chose jugée »…). Ce qui permettait à tout moment à des structures à l’existence douteuse, de pétitionner sur une surface libre de la carte officielle, pour un permis de recherches et ainsi acquérir des droits après rejet implicite. Heureusement malgré les trous de la loi « Hulot », ces demandes d’octroi ont toutes fait l’objet de confirmations écrites de rejets implicites. Hélas la forme de ces décisions est bien fragile. L’avenir demeure incertain sur cet aspect.
Par contre le mécanisme d’exception introduit par la loi dans l’article L111-12 du code minier pourrait, lors de l’examen des futures demandes de prolongation de concessions au-delà du 1er janvier 2040, être attaqué devant l’arbitrage privé. En effet le demandeur qui se verrait refuser une telle possibilité, ou celui insatisfait de la durée de prolongation proposée dans la navette du projet avant signature du décret, pourrait à ce moment là utiliser les notions de manque à gagner, etc. et choisir l’arbitrage à la juridiction administrative. C’est ce qu’ont laissé entendre notamment les filiales françaises de Vermilion en adressant des «contributions extérieures» au Conseil d’État en amont du dépôt du texte définitif du PJL « Hydrocarbures » le 6 septembre 2017 -différent de celui-présenté quelques jours plus tôt au CNTE- et permis l’orientation de l’avis du 1er septembre 2017.
Réformer le code minier ? Sans doute, mais d’abord comme l’Italie, sortir sans délai de la Charte !
* : Rockhopper Italia S.p.A., Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper Exploration Plc v. Italian Republic, ICSID Case No. ARB/17/14
VHF avec ML, MV, SC, ADLT Fr, ECTDS et TNI
.